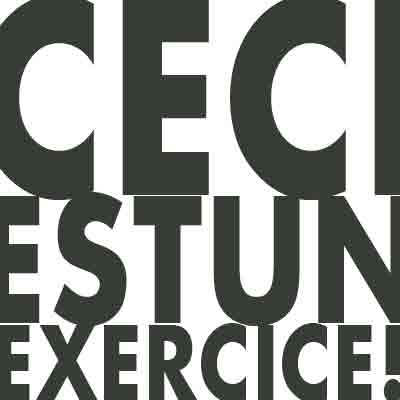Un kilomètre pour s'aérer l'esprit
Pendant ce (re)confinement, certains ont plus de chance que d'autres. Des Bordelais nous racontent à quoi ressemble le périmètre d'un kilomètre autour de leur domicile. Ils pointent les avantages et les inconvénients de leurs quartiers respectifs avec au bout du compte, quelques conséquences sur le moral.

Prendre une bonne bouffée d’air frais quotidienne. C’est le plaisir que peuvent s’offrir les citadins qui résident à moins d’un kilomètre d’un parc. Fabienne, cadre dans la fonction publique veut en profiter au maximum. Chaque matin, avant sa journée de télétravail, elle enfile ses baskets et sort courir au Parc Bordelais, comme nombre d’autres riverains. «Moralement, ça me détend avant d’attaquer ma journée» s’enthousiasme-t-elle.
Florilège de privilèges
Même constat pour Fernando, qui préfère les balades tranquilles à la course à pieds. Le jeune homme est confiné dans le quartier du Jardin Public. L’herbe y est bien verte, et la promenade d’autant plus agréable qu’en ce début de mois de novembre, le temps est clément. Alors, il arpente les allées du jardin botanique et les sentiers qui bordent le parc, croisant tour à tour des enfants qui chahutent et des séniors en pleine session de marche nordique. Lors de ces moments, il le reconnait lui même, il «se sent privilégié».
Verdure, calme, jolies rues, voisins sympathiques, pour ces chanceux du confinement, toutes les occasions sont bonnes pour sortir faire un tour. Dans la limite, bien sûr, du kilomètre autorisé. Fabienne avoue même trouver «des excuses pour sortir». On peut entendre l’envie de s'aérer.
Sur la rive droite, on fait état d’un sentiment similaire. Le privilège ultime: pouvoir accéder aux quais de la Garonne, avec vue imprenable sur l’autre rive. Frédéric habite non loin de la place Calixte Camelle, et si on lui demande où il préfèrerait être confiné, il répond simplement «Je suis bien ici.»
"Ça a un côté un peu déprimant"
Plus difficile en revanche pour les Bordelais du centre-ville et des quartiers plus bétonnés de la métropole.
Pour Chloé (le prénom a été modifié), étudiante de 23 ans du quartier Nansouty, les sorties ne sont pas vraiment un plaisir. Elle a passé son premier confinement à la campagne, chez ses parents, et le contraste est frappant avec sa vie citadine. Son petit appartement a vue sur un parking et un local à poubelles. Elle aurait donc bien besoin de changer de décor une heure par jour. Mais son quartier n’offre pas vraiment d’occasion de s’aérer le corps et l’esprit. «Ça manque énormément de verdure. En ces temps où on a particulièrement besoin de nature, ça a un coté un peu déprimant» regrette la jeune femme.
Entre la Victoire, la gare Saint-Jean et le cours de la Somme, pas d’îlot de verdure en effet. Les trottoirs sont petits, encombrés de poubelles et de voitures stationnées. L’étudiante évite donc de sortir. «Même si le quartier est joli, ce n’est pas agréable de s’y balader. Je me vois mal passer une heure à marcher autour de chez moi ! Et puis, il y a énormément de monde dans les rues.» se plaint-elle. Une promiscuité qui la décourage d’autant plus de sortir. Parce que le calme manque, mais aussi par peur du virus.
Urbano-déprimés
Chloé n'est pas la seule à subir une situation difficile. Déprime, anxiété, troubles du sommeil, les Bordelais des quartiers les plus étouffants accusent pour la plupart des coups au moral. Rappelons que selon CoviPrev, une enquête nationale de Santé publique France sur la santé mentale des français en temps de confinement, un adulte sur cinq a vécu un épisode dépressif au cours de l’année qui vient de s'écouler, contre un sur dix en 2017. Une forte augmentation qui s’explique par l'amincissement de la vie sociale, le sentiment d’enfermement et la perte de liberté de mouvement.
Lors du premier confinement, Santé publique France avait mesuré la proportion de personnes sujettes à un état dépressif parmi un échantillon de 2000 personnes. Début mai, la dernière semaine du confinement, 21,5% des personnes vivant en milieu urbain présentaient des troubles dépressifs, contre 16,1% en milieu rural. Notons que cet écart se creusait à mesure que le confinement se prolongeait.

Rendre leur quartier plus agréable aux citadins
3 questions à Dimitri Delage, urbaniste-aménageur
Le renforcement d’une «vie de quartier» revient souvent dans les préoccupations des habitants. Quelles sont les tendances en urbanisme qui vont dans ce sens ?
On constate le retour de plus petites centralités au sein de quartiers et de villes. On cherche à créer une économie circulaire qui renforce la proximité entre les acteurs. Le renforcement de la vie de quartier est le fruit de ce virage dans la manière de concevoir la ville. L’usage de plateformes de libre service et vente à emporter a aussi participé à l’attention portée à nos commerçants et sur le rôle du citoyen dans cette économie locale. Malheureusement le choix a été fait de ne laisser que de grandes surfaces ouvertes pendant le confinement. De nombreux commerces de proximité ont alors mis la clé sous la porte. C’est un enjeu, car cela remet en cause notre approche de la consommation. Dans les faits, renforcer la vie de quartier est complexe et les initiatives pour maintenir les petits commerces restent trop faibles.
Un des inconvénients de la vie citadine demeure le manque d’espace verts. Les habitants aspirent également à une moindre densité urbaine. Y-a-t-il des solutions ?
Depuis le début des années 2010 en France, le terme d’urbanisme durable est souvent utilisé. Il y a une prise de conscience sur l’importance de la nature en ville et sur l’étalement urbain ainsi qu'une remise en question de la mobilité. La nature en ville est un sujet qui revient dans l’élaboration de nombreux documents mais c’est une thématique qui peut très vite devenir une tendance géomarketting. Par exemple, les éco-quartiers sont de plus en plus critiqués pour leur manque de valeur écologique, malgré les labelisations obtenues. Le confinement nous a permis de constater les manques de certains espaces. Il a soulevé des nouveaux enjeux et va permettre, je l’espère, de réaménager certains secteurs qui ont manqué d’infrastructures ou d’aménagements paysagers de qualité.
Comment les préoccupations des citadins sont-elles prises en compte dans les travaux d’urbanisme ?
Dans les différents documents d’urbanisme, une liste d’équipements sont répertoriés pour le bon fonctionnement d’espaces, quartiers, ou villes. On cherche à rendre la ville plus active et douce pour les citoyens. C’est pourquoi on intègre de plus en plus la concertation publique dans les projets urbains afin de pouvoir co-construire la ville en essayant d’être au plus proche des attentes des habitants. La place de la nature en ville est un exemple de ces préoccupations. Il s'agit de questions déjà centrales dans l’élaboration de projets, schémas ou plan d’urbanisme. On assiste peut-être à un éveil chez certains acteurs de l’aménagement qui se souciaient moins de l’importance de ces éléments.

Rendre leur quartier plus agréable aux citadins
3 questions à Dimitri Delage, urbaniste-aménageur
Le renforcement d’une « vie de quartier » revient souvent dans les préoccupations des habitants. Quelles sont les tendances en urbanisme qui vont dans ce sens ?
On constate le retour de plus petites centralités au sein de quartiers et de villes. On cherche à créer une économie circulaire qui renforce la proximité entre les acteurs. Le renforcement de la vie de quartier est le fruit de ce virage dans la manière de concevoir la ville. L’usage de plateformes de libre service et vente à emporter a aussi participé à l’attention portée à nos commerçants et sur le rôle du citoyen dans cette économie locale. Malheureusement le choix a été fait de ne laisser que de grandes surfaces ouvertes pendant le confinement. De nombreux commerces de proximité ont alors mis la clé sous la porte. C’est un enjeu, car cela remet en cause notre approche de la consommation. Dans les faits, renforcer la vie de quartier est complexe et les initiatives pour maintenir les petits commerces restent trop faibles.
Un des inconvénients de la vie citadine demeure le manque d’espace verts. Les habitants aspirent également à une moindre densité urbaine. Y-a-t-il des solutions ?
Depuis le début des années 2010 en France, le terme d’urbanisme durable est souvent utilisé. Il y a une prise de conscience sur l’importance de la nature en ville et sur l’étalement urbain ainsi qu'une remise en question de la mobilité. La nature en ville est un sujet qui revient dans l’élaboration de nombreux documents mais c’est une thématique qui peut très vite devenir une tendance géomarketting. Par exemple, les éco-quartiers sont de plus en plus critiqués pour leur manque de valeur écologique, malgré les labelisations obtenues. Le confinement nous a permis de constater les manques de certains espaces. Il a soulevé des nouveaux enjeux et va permettre, je l’espère, de réaménager certains secteurs qui ont manqué d’infrastructures ou d’aménagements paysagers de qualité.
Comment les préoccupations des citadins sont-elles prises en compte dans les travaux d’urbanisme ?
Dans les différents documents d’urbanisme, une liste d’équipements sont répertoriés pour le bon fonctionnement d’espaces, quartiers, ou villes. On cherche à rendre la ville plus active et douce pour les citoyens. C’est pourquoi on intègre de plus en plus la concertation publique dans les projets urbains afin de pouvoir co-construire la ville en essayant d’être au plus proche des attentes des habitants. La place de la nature en ville est un exemple de ces préoccupations. Il s'agit de questions déjà centrales dans l’élaboration de projets, schémas ou plan d’urbanisme. On assiste peut-être à un éveil chez certains acteurs de l’aménagement qui se souciaient moins de l’importance de ces éléments.
Petits plaisirs dans la jungle de béton
Pendant ce temps, autour de chez lui, Fernando, le jeune riverain du quartier du Jardin public profite tout de même d’un avantage de la vie citadine. Il ironise: «Dans mon quartier, on a la chance de trouver des endroits où acheter des produits de qualité. Bien manger, c'est un peu le seul plaisir qu'il nous reste». De petits commerces de bouche à chaque coin de rue, cela permet d’éviter les foules des hypermarchés. Et pour éviter de cuisiner, certains Bordelais plébiscitent également la possibilité de se faire livrer un repas, ou de le récupérer en «clique et collecte». De petits plaisirs du quotidien qui redonnent de la saveur à une vie confinée pas toujours facile. Pas suffisant pour Chloé: «Les avantages de vivre en ville, en temps de confinement, ils n’existent plus. La facilité d'aller au restaurant, d'aller au cinéma ou de voir des amis n'existe plus, vu que ce sont des choses qu'on n'a plus le droit de faire». Des regrets et une frustration bien présents, pour un confinement démoralisant.
Trucs et astuces de confinés
Pas de parc pour aller courir, impossible de s'entendre penser derrière le bruit des voitures, le sentiment d'étouffer entre les façades d'immeubles. Pour palier ces inconvénients, les Bordelais les moins privilégiés font ce qu'ils peuvent. Ils trouvent des solutions avec ce qu'ils ont à portée de kilomètre.
Marie, jeune riveraine du quartier Saint-Augustin qu’elle qualifie de résidentiel et familial, compte l’hôpital Pellegrin dans son périmètre. Problème, les sirènes des ambulances résonnent en permanence autour de chez-elle. S’ajoutent à cela le bruit et la pollution induits par les grands boulevard qui quadrillent le secteur. Elle préfère donc la nuit pour sa promenade quotidienne. «Je dois sortir tous les jours, sinon moralement ça ne va pas. Parfois, je sors faire un tour la nuit, quand le trafic et la pollution sont moins importants» confie-t-elle. Camille, confinée tout près de chez Marie tire au contraire parti de la présence du CHU dans son périmètre: «Il y a du mouvement, je vois passer les étudiants en médecine, les gens qui circulent dans l’hôpital. Il y a de l’espace, de grandes surfaces, ça change un peu d’air.» explique-t-elle. Son autre astuce ? Faire fi des restrictions de distance imposées par le confinement quand le besoin de changer d'atmosphère se fait trop présent.
Marie, elle, a trouvé une autre option assez originale pour se promener à l’air libre. Elle déambule dans les allées du cimetière de La Chartreuse. 25,7 hectares de calme restés ouverts pendant la crise sanitaire. «Ça peut paraître un peu glauque» s’amuse-t-elle. Disons plutôt que faute de grives, on mange des merles.
Toutes ces solutions aident à adoucir le confinement et ses incommodités. Malgré tout, Bordelais privilégiés ou non s’accordent avec ces mots de Fernando «Pour être confiné, l’idéal, c’est quand même en campagne ou au bord de la mer, là où il y a de l’espace». En effet, plus bénéfique pour le moral de prendre l’air là où il y en a.
Océane Provin

CHU Pellegrin à Bordeaux (Image Wiki Commons)
CHU Pellegrin à Bordeaux (Image Wiki Commons)

Cimetière de la Chartreuse (Image WikiCommons)
Cimetière de la Chartreuse (Image WikiCommons)