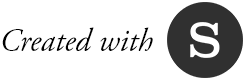Bordeaux : un an après, le mouvement tend à perdurer à travers différentes formes

Samedi 17 novembre 2019, les gilets jaunes fêtaient leur premier anniversaire. Entre 28 000 et 44 000 personnes ont manifesté partout en France pour l’acte 53, dont 1 800 à Bordeaux, l’une des capitales de la mobilisation. Un regain par rapport aux semaines précédentes mais bien loin des pics de mobilisation de l’année dernière. En un an, le mouvement a eu le temps de se transformer, de se politiser, mais semble, à la surprise de nombreux chercheur.se.s, s’inscrire dans le temps, se stabiliser grâce à la mobilisation d’une base de manifestant.e.s bien solide. Les gilets jaunes s'imprègnent de leur environnements, du contexte et se pérennisent à travers des formes de plus en plus variées.
Ce 17 novembre 2019 n’était pas un samedi “gilets jaunes” comme les autres puisque le mouvement fêtait son premier anniversaire. Si les revendications sont toujours présentes, l’ambiance est à la fête. Ballons de baudruche et déguisements à l’honneur. Adrien, 22 ans, arbore fièrement son gilet jaune. Inscrit dans son dos : “Notre travail, leur profit, à eux de suer”. Ce gilet jaune de la première heure, également militant au Nouveau Parti anti-capitaliste, a donc pu constater les évolutions de son mouvement porté par des personnes de plus en plus politisées. Il a vu en ce mouvement une nouvelle manière de faire de la politique, en dehors des institutions, “au sens le plus pur”.
Des études vont dans son sens. Depuis les premières mobilisations de gilets jaunes, il y a un an, les profils des manifestant.e.s ont évolué. C’est ce que démontre une étude menée à travers 26 communes et 15 départements par Camille Bedock, chargée de recherche au CNRS, Centre Emile Durkheim : de plus en plus appartiennent à des syndicats et des partis politiques. “49% des gens interrogés avant le 8 décembre étaient primo-manifestant.e.s”. Après cette date, le mouvement est investi par des personnes qui ont déjà pris part à des activités militantes en dehors des gilets jaunes. À partir de ce moment de “politisation du mouvement”, il est devenu plus compliqué pour la frange la moins expérimentée des gilets jaunes, de trouver sa légitimité. Après début janvier c’est donc 73% des individus qui avaient une expérience militante avant le début des gilets jaunes. Dans le même temps, les personnes qui n’avaient aucune expérience sont devenues de “vrai.e.s militant.e.s, ils ont appris à construire une structure de mobilisation” souligne la sociologue.
Le coeur du mouvement, plus politisé mais plus précaire
Depuis l’apogée du mouvement, en novembre 2018 avec ses 287 000 manifestants, les mobilisations n’augmentent pas. Elles ont même connues de fortes baisses. Pourtant, depuis plusieurs semaines les chiffres se stabilisent. Pour Adrien, les gilets jaunes le doivent à une base militante qui s’est progressivement solidifiée. À Bordeaux, l’étudiant engagé constate que depuis quelques mois c’est le même noyau dur d’environ 700 personnes qui se rend au rendez-vous hebdomadaire de 14 heures, Place de la Bourse. Le militant de 22 ans affirme qu’il s’agit de la part la plus précaire du mouvement. “Les premières semaines il y avait beaucoup d’actifs, de commerçant.e.s qui n’arrivaient pas à finir les fins de mois, et petit à petit, ils se sont désolidarisés car les plus pauvres d’entre-nous sont les plus déterminé.e.s.” Samedi 17 novembre, quelque 1800 personnes ont investi les rues de Bordeaux, sous une pluie diluvienne. Après trois heures de manifestation, seul 700 personnes se sont données rendez-vous en centre-ville afin de poursuivre l’action. Un groupe de militant.e.s restreint mais déterminé.e.s qui n’est, selon Adrien, pas prêt de lâcher.
C’est également l’avis de Camille Bedock qui estime que si les personnes éloignées du monde du travail manifestent depuis aussi longtemps c’est parce que “les revendications sont plus fortes”. Les chiffres de son enquête pour la revue française de science politique sont éloquents : sur les 26 communes étudiées, 16% des gilets jaunes sont au chômage, 5% sont en situation de handicap et 25% ont un revenu par foyer inférieur à 1200 euros par mois. À Bordeaux en particulier, Frédéric Neyrat, professeur de sociologie à l’université de Rouen qui s’est penché sur le mouvement des gilets jaunes à Bordeaux pour une étude nationale explique que la baisse du pouvoir d’achat ont fait de la ville un centre actif du mouvement. "La bourgeoisie traditionnelle, doublée d'une nouvelle bourgeoisie fait monter le coût de la vie crée des dynamiques de gentrification qui relaye les classes de plus en plus populaires en dehors de la ville".
La solidarité, carburant des mobilisations
“Les gens ont le sentiment de laisser de côté leurs appartenances habituelles pour se joindre à quelque chose de plus grand qu’eux”
Chaque samedi, Adrien retrouve ses “camarades”, tous dans la même tranche d’âge mais qui viennent de régions et de milieux sociologiques très variés. Le mouvement des gilets jaunes est un cas d’école par son hétérogénéité. “Il y a des divergences mais malgré tout il y a des formes de sociabilité nouvelles rendant les manifestant.e.s interdépendant.e.s” observe Frédéric Neyrat. Selon lui, la solidarité et les relations qui sont nées du mouvement des gilets jaunes en sont le carburant.
“Les gens ont le sentiment de laisser de côté leurs appartenances habituelles pour se joindre à quelque chose de plus grand qu’eux” appui la chercheuse, Camille Bedock. Lors de ses différentes enquêtes de terrain, beaucoup ont souligné qu’ils rencontrent des personnes éloignées de leur propre cercle d’amis. “À Bordeaux c’est frappant, il peut y avoir des gens qui viennent des deux bords et on aurait pas imaginé les voir manifester ensemble. Ils considèrent que c’est plus important que les clivages politiques” explique Camille Bedock qui voit en cette solidarité le ciment des mobilisations, et la raison pour laquelle elles perdureront.
Des revendications plus politiques
Des pancartes réclamant le RIC (référendum d’initiative citoyenne), figure de proue du mouvement, sont présentes dans le cortège. Pour Frédéric Neyrat, c’est un signe que le discours des gilets jaunes s’est affiné à mesure qu’ils se sont politisés. Si depuis le début du mouvement le pouvoir d’achat est en premières ligne, les expert.e.s s’accordent à dire que les revendications institutionnelles se sont progressivement imposées. "Il y a une volonté de repenser la représentation politique, la démocratie, pour rendre les élu.e.s plus proches du peuples” atteste Adrien, l’étudiant militant. Il regrette toutefois que les gilets jaunes ne parviennent pas suffisamment à s’emparer de sujets sociétaux qui nous concerne tous.
“La seule actualité des gilets jaunes, ce sont les gilets jaunes”
Entrée en vigueur le 1er novembre dernier, la réforme de l’assurance chômage n’a donné lui à aucune mobilisation. “Le mépris de classe de Macron est repris toutes les semaines mais pour l’assurance chômage ou les retraites il ne se passe rien”. C’est un point que déplore le jeune gilet : le mouvement peine à se renouveler car l’agenda des contestations est trop souvent lié au mouvement en lui-même. « La seule actualité des gilets jaunes, ce sont les gilets jaunes ». Le mouvement perdure mais s’endort, cantonné à une contestation anti-élites. Pour Adrien, les gilets jaunes sont défaitistes et peinent à croire en d'autres mobilisations. Alors que quelques jours auparavant, Anas, étudiant Lyonnais, s’immolait par le feu pour alerter les pouvoirs publics sur la précarité étudiante, à la surprise d’Adrien, très peu d’étudiants étaient présents le 17 novembre à Bordeaux et aucune action particulière n’avait été organisée.
Opposer le “nous” au “eux” a été et est encore la ligne directrice des mobilisations. “Une manière de rester unis malgré les divergences d’opinion” estime Camille Bedock. Tout particulièrement à Bordeaux qui s’est rapidement distinguée dans le mouvement comme une place forte. “Je pensais que le mouvement allait se diviser mais aujourd’hui ça continue. Pourtant, de plus en plus de fractions de gilets jaunes vont rejoindre d’autres mouvements” selon la chercheuse au CNRS. Une convergence des luttes sera-t-elle alors une façon de s’adapter aux nouvelles formes qu’il prend ?
“On a essayé une convergence des luttes, ça a été un échec”
“Urgences sociales et climatiques” pouvait-on lire sur une pancarte d’Extinction Rebellion à la manifestation anniversaire des gilets jaunes, ce samedi à Bordeaux. Pour l’avenir du mouvement, une convergence des luttes serait cruciale pour amplifier la mobilisation, selon le sociologue Frédéric Neyrat, mais elle n’est pas encore évidente qu’un point de vue quantitatif. Adrien, gilet jaune, est assez pessimiste quant à la capacité du mouvement à converger unanimement avec d’autres luttes. “ Il n’y a aucune coordination nationale. On a essayé une convergence avec le climat en septembre. Ça a été un échec parce que nous ne venons pas du même milieu social mais surtout nous n’avons pas les mêmes méthodes militantes. Les écologiste sont légalistes, il sera compliqué de parler d’une même voix”. La grève nationale du 5 décembre prochain contre la réforme des retraites pourrait être un moment crucial. Pour Camille Bedock, “la retraite est présente dans les revendications des gilets jaunes, le 5 décembre sera donc le vrai test”. Peut-être parviendront-ils à s’entendre sur ce sujet finalement...
Apprendre à composer pour la longévité
“ Le mouvement des gilets jaunes n’est pas une pure révolte anti-fiscale, n’est ni de droite, ni de gauche. Il regroupe des gens très durables. Il est pour beaucoup d’entre-eux, un réel apprentissage de la politique”
En fêtant son premier anniversaire, le mouvement prouve qu’il a trouvé une stabilité dans le temps et ce notamment au fonctionnement très horizontal du groupe de militant.e.s. Même si certaines figures des gilets jaunes sont sorties de l’anonymat grâce aux médias, selon Camille Bedock “aucun leader n’a émergé” à proprement parler. À Bordeaux, “bastion de la violence des gilets jaunes”, les militant.e.s ont également appris à appréhender les stratégies policières très dures afin de pouvoir manifester plus librement chaque samedi.
Comme le rappellent les expert.e.s, une nouvelle préfète a été nommée pour remplacer Didier Lallement en mars dernier. Depuis, le dispositif est encore plus strict, plus agressif, avec des pratiques de nasse, et certains week-end des chars, des hélicoptères. Une stratégie assumée des responsables politiques pour que “les gens rentrent chez eux”. Ainsi, une grande partie des militant.e.s ne portent plus de gilets jaunes en manifestation ou se donnent des rendez-vous par petits groupes comme ça a été le cas pour l’acte 53.
“ Le mouvement des gilets jaunes n’est pas une pure révolte anti-fiscale, n’est ni de droite, ni de gauche.” Il regroupe des personnes qui ont réussi à se mobiliser de façon durable. “Pour beaucoup d’entre-eux, c’est un réel apprentissage de la politique” résume Camille Bedock après des mois d’enquête sur le terrain. Adrien, le jeune gilet jaune affirme qu’ils ne rentreront que quand ils auront obtenu ce qu’ils veulent mais relève que tout le monde ne veut pas la même chose. Ils sont déjà parvenus à créer en un an un lieu de discussion collective et ils continueront sans doute à chercher à institutionnaliser un espace pour faire remonter les différentes revendications. Ne reste plus qu’à attendre de voir émerger les différentes formes que prendra le mouvement. Le 5 décembre sera un réel moyen de tester la mobilisation et les élections municipales pourrait être une étape cruciale : vont-ils se mobiliser sur des listes autonomes ou se fondre dans l’offre politique classique? L’avenir nous le dira.
1. Collectif d'enquête sur les Gilets jaunes, "Enquêter in situ par questionnaire sur une mobilisation en cours : une étude sur les Gilets jaunes", Revue française de science politique, 69 (5-6), 2019.